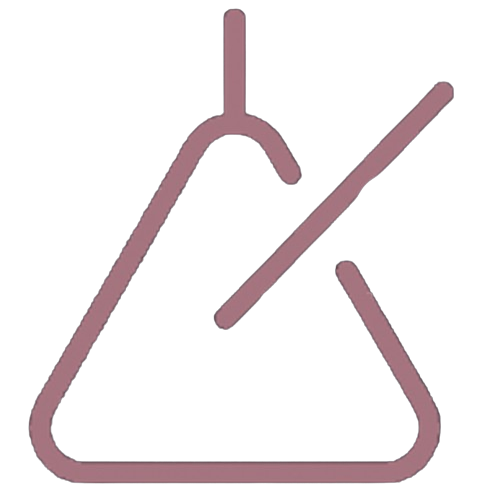Partons aujourd’hui à la découverte de l’Arpeggione, un instrument qui a su intriguer les musiciens par son caractère hybride et sa courte existence. Bien que peu connu du grand public, l’Arpeggione a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique classique grâce à des œuvres emblématiques (merci Schubert !). On vous dit tout sur l’Arpeggione, bonne lecture !
Pour commencer, d’où vient l’Arpeggione ?
L’Arpeggione voit le jour en 1823 grâce à Johann Georg Stauffer, un luthier viennois réputé pour ses innovations. À cette époque, Vienne est un véritable carrefour musical où se rencontrent compositeurs et instrumentistes en quête de nouvelles sonorités. C’est dans ce contexte effervescent que naît l’Arpeggione, conçu pour combiner les qualités expressives du violoncelle avec la facilité de jeu de la guitare.
Malgré son potentiel, l’Arpeggione ne connaît qu’une brève période de popularité. Sa conception complexe et le manque de répertoire dédié limitent sa diffusion. Cependant, il attire l’attention de Franz Schubert qui compose une sonate spécifiquement pour cet instrument en 1824. Cette œuvre reste l’une des rares compositions écrites pour l’Arpeggione et contribue à sa notoriété posthume.
La disparition rapide de cet instrument s’explique par plusieurs facteurs : la concurrence d’autres instruments plus établis et la difficulté technique qu’il présente aux musiciens. En dépit de ces obstacles, l’Arpeggione continue d’intriguer par son histoire singulière et son timbre unique.
L’Arpeggione, un violoncelle-guitare oublié du XIXᵉ siècle
L’Arpeggione se distingue par sa forme atypique qui rappelle celle d’un violoncelle mais avec six cordes accordées comme une guitare. Cette particularité lui confère une palette sonore riche et variée, capable d’exprimer des nuances subtiles. C’est cette dualité qui fascine les musiciens, bien que peu nombreux soient ceux qui maîtrisent cet instrument aujourd’hui.
Conçu pour être joué avec un archet comme le violoncelle, il offre néanmoins une approche différente grâce à son manche fretté similaire à celui d’une guitare. Cette caractéristique permet une grande précision dans le jeu des accords et des arpèges, ouvrant ainsi des possibilités harmoniques inédites à l’époque.
Malgré ses qualités indéniables, l’Arpeggione n’a pas réussi à s’imposer durablement dans le paysage musical du XIXᵉ siècle. Il reste cependant un témoin précieux des expérimentations instrumentales qui ont marqué cette période riche en innovations.
Comment joue-t-on de l’Arpeggione ?
Jouer de l’Arpeggione nécessite une technique particulière qui combine des éléments empruntés au violoncelle et à la guitare. L’instrument se tient entre les genoux comme un violoncelle, mais ses six cordes sont pincées ou frottées avec un archet selon les besoins expressifs du morceau interprété.
L’accordage est identique à celui d’une guitare classique : mi-la-ré-sol-si-mi. Cela permet aux guitaristes d’aborder plus facilement cet instrument tout en exploitant les possibilités offertes par le jeu à l’archet. Cependant, la maîtrise de cette technique hybride demande une certaine adaptation, car elle diffère sensiblement des méthodes traditionnelles enseignées aux violoncellistes ou guitaristes.
L’un des défis majeurs réside dans la gestion du vibrato et du legato propres au jeu avec archet sur un manche fretté. Les musiciens doivent faire preuve d’une grande sensibilité pour tirer pleinement parti des capacités expressives offertes par cet instrument singulier.
Que devient l’Arpeggione aujourd’hui ?
Bien que l’Arpeggione ait disparu des scènes musicales peu après sa création, il connaît un regain d’intérêt parmi les musiciens et les luthiers passionnés par les instruments anciens. Des répliques modernes sont fabriquées pour satisfaire la curiosité des interprètes désireux d’explorer son répertoire limité mais fascinant.
La sonate pour Arpeggione de Schubert, transcrite pour d’autres instruments comme le violoncelle ou l’alto, reste la principale œuvre associée à cet instrument. Elle est souvent interprétée lors de concerts dédiés à la musique de chambre, permettant ainsi à l’Arpeggione de revivre à travers ces adaptations.
Certains musiciens contemporains choisissent également de composer de nouvelles pièces pour cet instrument, contribuant ainsi à enrichir son répertoire. Cet intérêt renouvelé témoigne de la fascination persistante qu’exerce l’Arpeggione sur les artistes en quête de sonorités oubliées.
Ainsi, bien que rarement joué dans sa forme originale, l’Arpeggione continue d’inspirer et d’émerveiller ceux qui s’aventurent sur ses traces. Il incarne une part du patrimoine musical que certains cherchent à préserver et à faire revivre.
3 choses insolites à savoir sur le Arpeggione (pour briller en société)
L’instrument aux multiples noms
L’Arpeggione est parfois appelé « guitare-violoncelle », en raison de sa conception hybride. Ce surnom reflète bien la dualité qui caractérise cet instrument unique en son genre.
Un compositeur célèbre derrière sa notoriété
Bien que peu connu du grand public, c’est grâce à Franz Schubert que l’Arpeggione a acquis une certaine renommée. Sa sonate pour Arpeggione et piano reste aujourd’hui encore une pièce incontournable du répertoire classique.
Une résurrection moderne inattendue
Dans les années 2000, certains luthiers ont entrepris de reproduire des Arpeggiones afin de redonner vie à cet instrument oublié. Cet engouement récent montre que même les instruments disparus peuvent connaître une seconde jeunesse, portée par la passion des musiciens et artisans d’aujourd’hui.
Ces articles pourraient également vous intéresser :
- Le piano qui joue tout seul : l’histoire des pianos mécaniques
- L’étrange histoire du duel musical entre Beethoven et Steibelt
- La Symphonie Inachevée de Schubert : un mystère toujours fascinant
- Le chef d’orchestre qui dirige… avec un cure-dent

Article proposé par Jordane
Pianiste depuis l'âge de 8 ans et passionné de musique, Jordane chante aujourd'hui dans plusieurs chœurs, où il continue de perfectionner sa voix de ténor. Curieux et amoureux du répertoire classique, il partage avec enthousiasme ses conseils pour accompagner les musiciens débutants et passionnés dans leur apprentissage.