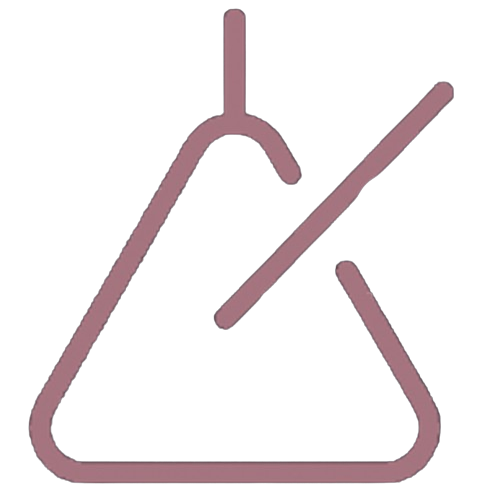La clarinette est aujourd’hui l’un des instruments à vent les plus populaires et les plus polyvalents. Présente dans les orchestres symphoniques comme dans les groupes de jazz, les fanfares ou les musiques du monde, elle séduit par sa sonorité riche, expressive et modulable.
Mais comment cet instrument a-t-il vu le jour et comment a-t-il évolué au fil des siècles pour devenir celui que nous connaissons ? Des premiers chalumeaux baroques aux clarinettes actuelles en passant par les innovations du 19ème siècle, retracez avec nous la passionnante épopée de la clarinette !
Les origines de la clarinette (début du 18ème siècle)
Notre histoire commence au début du 18ème siècle, dans l’effervescence musicale de l’ère baroque. À cette époque, les orchestres comptent déjà de nombreux instruments à vent comme les flûtes, les bassons ou les hautbois. Mais un nouveau venu s’apprête à faire son entrée : le chalumeau.
Le chalumeau est l’ancêtre direct de la clarinette. Il s’agit d’un instrument à anche simple, taillé dans un roseau ou un bois tendre, et percé de huit trous. Son timbre est doux et velouté, mais son ambitus est limité à une octave. Il est surtout utilisé dans la musique de danse et les airs populaires.

C’est en cherchant à améliorer le chalumeau que les premiers facteurs d’instruments vont poser les bases de la clarinette. Deux noms se distinguent particulièrement : Johann Christoph Denner et Jacob Oberlender, tous deux établis à Nuremberg.
Vers 1700, J.C. Denner a l’idée d’ajouter deux clés au chalumeau : une pour le pouce de la main gauche, permettant de descendre d’une douzième, et une pour l’auriculaire de la main droite, permettant de monter d’une seconde. Ces clés élargissent considérablement la tessiture de l’instrument et lui donnent son nom : la clarinette, du latin « clarinetto » qui signifie « petit clairon ».
Quelques années plus tard, Oberlender perfectionne le système en ajoutant une troisième clé pour le sol dièse. La clarinette baroque à trois clés est née ! Elle conquiert rapidement les orchestres et les salons par sa sonorité lumineuse et expressive, notamment dans le registre aigu appelé « clairon ».

Les compositeurs s’emparent de ce nouvel instrument et lui offrent ses premières lettres de noblesse. Vivaldi, Haendel, Rameau intègrent la clarinette dans certaines de leurs œuvres, souvent par deux. Mais c’est surtout dans la musique de chambre et les orchestres de plein air que la clarinette s’impose, grâce à son timbre qui porte loin.
Tout au long du 18ème siècle, la facture des clarinettes se perfectionne. On voit apparaître des modèles de clarinette à 4, 5 ou 6 clés, permettant de jouer dans différentes tonalités. Le bois d’ébène remplace progressivement le buis ou le poirier. L’anche, d’abord taillée dans le bec, est ensuite fixée par une ligature. Autant d’améliorations qui préparent la grande révolution du siècle suivant.
L’évolution de la clarinette classique (19ème-20ème siècle)

Le début du 19ème siècle marque un tournant pour la clarinette, grâce au génie d’un homme : Ivan Müller. Ce facteur et clarinettiste estonien, établi à Paris, est le père de la clarinette moderne. En 1812, il présente un instrument révolutionnaire : la clarinette omnitonique à 13 clés.
L’idée de Müller est d’équiper la clarinette de clés couvrant tous les trous, actionnées par des anneaux mobiles. Cela permet d’obtenir une échelle chromatique complète et égale sur toute la tessiture, ainsi que des doigtés rationnels et similaires dans tous les tons. Fini le casse-tête des doigtés fourchus et des notes sourdes !
Malgré des débuts difficiles, le système Müller s’impose progressivement dans toute l’Europe. Il est encore affiné par les facteurs Klosé et Buffet qui mettent au point la clarinette à anneaux mobiles, comportant jusqu’à 24 clés et 4 anneaux. C’est la naissance des grandes clarinettes « système français », encore utilisées aujourd’hui dans de nombreux pays.

Parallèlement, un autre système révolutionne le monde des bois : le système Boehm, mis au point par le flûtiste éponyme. Appliqué aux clarinettes par Eugène Albert dans les années 1840, il repose sur des anneaux et des plateaux perforés actionnant un jeu complexe de clés. Son but : un doigté encore plus logique et ergonomique.
Le système Boehm rencontre un grand succès dans les pays anglo-saxons et en Europe centrale. Il donne naissance aux clarinettes « système allemand », restées en usage dans ces régions. Ainsi s’établit le grand « schisme » entre les deux principaux systèmes de clarinettes modernes.
Grâce à ces innovations, le répertoire de la clarinette explose littéralement au 19ème siècle. Les compositeurs romantiques sont fascinés par sa sonorité tour à tour lyrique, dramatique ou virtuose. Mozart lui dédie son célèbre Concerto en 1791, Weber ses éblouissantes variations. Brahms, Schumann, Tchaïkovski, tous mettent la clarinette à l’honneur dans leurs œuvres symphoniques et chambristes.
Cette ferveur créatrice se poursuit au 20ème siècle, quand le répertoire de la clarinette s’ouvre à la modernité. Debussy, Stravinski, Bartok et bien d’autres explorent de nouvelles sonorités et de nouvelles techniques de jeu comme le flatterzunge, les quarts de ton ou le slap.
Certains vont jusqu’à prévoir des clarinettes peu usitées comme la clarinette en la de Rhapsodie de Debussy (1910) ou la clarinette contrebasse du Sacre du Printemps de Stravinsky (1913).
Les concertos pour clarinette fleurissent aussi sous les doigts de compositeurs comme Nielsen, Copland, Françaix ou Finzi. L’instrument n’a jamais semblé aussi virtuose, aussi expressif, aussi universel.
Cette universalité, la clarinette la doit aussi à ses interprètes d’exception qui en ont fait la démonstration. Comment ne pas citer Anton Stadler, dédicataire du Concerto de Mozart, qui fit briller la clarinette dans toute l’Europe ? Ou Richard Mühlfeld, qui sut inspirer les plus belles pages à Brahms ? Sans oublier les grands solistes du 20ème siècle comme Louis Cahuzac, Jacques Lancelot ou Stanley Drucker qui portèrent l’art de la clarinette à son apogée.
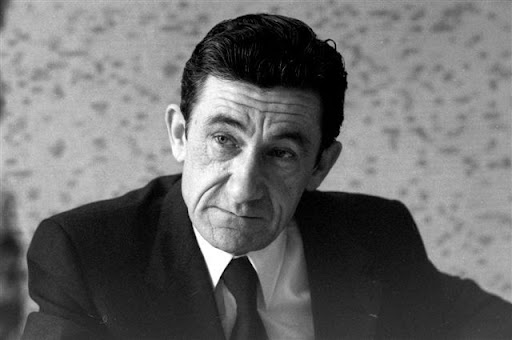
La clarinette dans le jazz et les musiques actuelles (20ème-21ème siècle)
Nous sommes au début du 20ème siècle, dans les bouillonnants quartiers de La Nouvelle-Orléans. C’est là, au cœur du creuset afro-américain, que la clarinette va connaître sa seconde révolution : le jazz.
Dans les brass bands et les orchestres de danse, la clarinette apporte sa touche mélodique et improvisée, aux côtés des cuivres et des banjos. Son timbre chantant et expressif en fait l’instrument roi des parades et des bals populaires. Bientôt, elle va donner naissance à un nouveau style : le New Orleans, porté par des pionniers comme Johnny Dodds, Jimmy Noone ou Barney Bigard.
Mais c’est surtout dans les années 1930-40, avec l’avènement du swing, que la clarinette va briller de tous ses feux. Dans les grands orchestres de l’ère des big bands, elle tient le rôle principal aux côtés des trompettes et des saxophones. Sa sonorité chaude et souple, sa vélocité et sa capacité à s’adapter aux sections comme aux chorus en font l’instrument emblématique de cette période fastueuse.
Impossible d’évoquer le swing sans mentionner les deux géants qui ont fait de la clarinette un instrument de légende : Benny Goodman et Artie Shaw. Le premier, surnommé « The King of Swing », électrise les foules avec son jeu virtuose et endiablé, illustré par des standards comme « Sing Sing Sing ». Le second apporte une touche plus nonchalante et éthérée, avec des chorus d’anthologie sur « Begin the Beguine » ou « Stardust ». Tous deux portent la clarinette jazz à son sommet et inspirent des générations de musiciens.
Dans les années 1940-50, avec l’avènement du be-bop et du cool, la clarinette passe un peu au second plan, éclipsée par le saxophone alto et ténor. Mais elle ne disparaît pas pour autant ! On la retrouve sous les doigts d’improvisateurs de génie comme Buddy DeFranco, Tony Scott ou Jimmy Giuffre qui la poussent vers de nouveaux horizons harmoniques et rythmiques.
Et que dire de Sidney Bechet, clarinettiste et soprano aux racines créoles, qui fera swinguer la France d’après-guerre avec ses envolées flamboyantes et lyriques ? Son jeu chaleureux et extraverti influencera toute une génération de musiciens européens et contribuera à populariser le jazz de ce côté-ci de l’Atlantique.
Au fil du 20ème siècle, la clarinette jazz continue d’évoluer et de se réinventer. Avec l’arrivée des instruments en métal comme la clarinette basse, le contralto ou les modèles en ut, mi bémol et la, de nouvelles possibilités sonores et expressives s’offrent aux musiciens. On pense à la clarinette basse veloutée d’Eric Dolphy, à la clarinette contralto incisive de John Carter ou à la petite clarinette mi bémol virevoltante d’Acker Bilk.
La clarinette s’invite aussi dans d’autres styles comme le free jazz (John Carter, Perry Robinson), le jazz rock (Eddie Daniels), le klezmer (Giora Feidman, David Krakauer) ou les musiques latines (Paquito d’Rivera). Autant de territoires qu’elle explore avec sa curiosité et sa ductilité légendaires.
Et aujourd’hui ? La clarinette n’a pas dit son dernier mot ! De jeunes loups comme Anat Cohen, Shabaka Hutchings ou Louis Sclavis lui insufflent un nouvel élan créatif, entre tradition et avant-garde. Dans leurs bouches, la clarinette se fait tour à tour hypnotique, poétique, subversive, toujours à la pointe de la création musicale actuelle. La preuve que cet instrument bicentenaire a encore de belles pages à écrire !
Conclusion
Des premiers chalumeaux baroques aux expérimentations les plus contemporaines, notre voyage historique s’achève. En trois siècles, la clarinette a parcouru un chemin extraordinaire, jonché de rencontres, d’inventions et d’émotions. D’abord timide comparse dans les orchestres classiques, elle est devenue une figure incontournable des musiques savantes comme populaires, portée par des interprètes et des compositeurs visionnaires.
Mais plus qu’un simple instrument, la clarinette incarne un certain esprit de la musique : celui de la générosité, de la fantaisie et de la liberté. De Mozart à Goodman, de Brahms à Bechet, elle n’a eu de cesse de se réinventer pour mieux nous toucher et nous faire rêver. Alors, longue vie à la clarinette, cette éternelle funambule du son et de l’âme !
Aller plus loin
Ne partez pas si vite, ces articles pourraient aussi vous intéresser :
– La clarinette, une grande famille ! Tour d’horizon
– Apprendre la clarinette à l’âge adulte : un guide pour débuter en toute confiance
– Comment initier votre enfant à la clarinette : méthodes et astuces
– Les clés pour trouver le professeur de clarinette idéal

Article proposé par Jordane
Pianiste depuis l'âge de 8 ans et passionné de musique, Jordane chante aujourd'hui dans plusieurs chœurs, où il continue de perfectionner sa voix de ténor. Curieux et amoureux du répertoire classique, il partage avec enthousiasme ses conseils pour accompagner les musiciens débutants et passionnés dans leur apprentissage.